![]() Les intérêts patrimoniaux
Les intérêts patrimoniaux![]()
(Biodiversité, ressources fourragères, ressources cynégétiques-halieutiques)
![]() Les intérêts fonctionnels
Les intérêts fonctionnels![]()
(régulation du régime des eaux)
![]() Intérêts paléo-écologiques:
Intérêts paléo-écologiques:![]()
La palynologie
(une mémoire du passé..)
![]() Les intérêts patrimoniaux
Les intérêts patrimoniaux![]()
(Biodiversité, ressources fourragères, ressources cynégétiques-halieutiques)
![]() Les intérêts fonctionnels
Les intérêts fonctionnels![]()
(régulation du régime des eaux)
![]() Intérêts paléo-écologiques:
Intérêts paléo-écologiques:![]()
La palynologie
(une mémoire du passé..)
| Intérêts patrimoniaux |
|


Les tourbières qui couvrent moins de 0.1% de la surface du territoire de Midi-Pyrénées, pourraient accueillir plus de 10% des espèces végétales rares de la région.
Des espèces en marge de leur aire de répartition géographique
En Europe, les tourbières se situent essentiellement au nord du 50° parallèle (excepté la zone arctique au climat trop rigoureux). A des latitudes plus basses, entre le 50ème et le 40ème parallèle, les tourbières compensent l'effet latitudinal en se développant en altitude. La surface de tourbière diminue pour être quasiment nulle à la latitude de l'Espagne et de l'Italie centrale.
Par la position géographique qu'occupe la région, par les conditions écologiques particulières des biotopes tourbeux, on observe en Midi-Pyrénées, deux groupes d'espèces qui fréquentent les tourbières, en marge de leur aire de distribution principale: les espèces atlantiques en limite d'aire orientale et les espèces boréales ou artico-alpines en limite d'aire méridionale. Ces populations, en limite d'aire pour certaines, en situation d'aire disjointe pour d'autres, renforcent l'intérêt que l'on peut porter aux tourbières de la région.
Certains vertébrés aussi se réfugient dans les tourbières pour compenser l'effet latitudinal.
Une biodiversité encore méconnue
Si la connaissance de la flore supérieure est maintenant assez satisfaisante, les études portant sur d'autres groupes, notamment les invertébrés fréquentant les tourbières, sont encore fragmentaires. On peut cependant noter quelques espèces d'insectes considérées comme menacées en France (Livre rouge national ), et citées en Midi-Pyrénées, soit dans le cadre de l'inventaire des tourbières, soit de diverses sources.
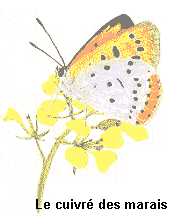
|

|
Au niveau des ressources halieutiques, les zones tourbeuses, pour la plupart oligotrophes, ne fournissent pas une source alimentaire suffisante pour permettre une production de biomasse aquatique importante. Cependant, situées souvent en tête de bassin versant, les zones tourbeuses permettent d'alimenter régulièrement en eau de qualité les rivières, favorisant ainsi la vie piscicole. Certains ruisseaux traversant des zones tourbeuses de type soligène et topogène, constituent des zones de frayères de qualité pour les truites. Ils accueillent aussi des populations d'écrevisses.
|
Intérêts fonctionnels |
|
Pour les tourbières ombrogènes bombées, il a été montré qu'il y a une faible contribution au régime des eaux du bassin versant (MIOUZE C., 1987).
Le cas des tourbières topogènes et soligènes est tout différent. Il a été étudié à l'échelle des bassins versants par François GAZELLE dans le sud du Massif Central.

Il s'avère que les tourbières de ce type constituent en quelque sorte une "grosse éponge" . Ainsi, elles assurent:
- le soutien d'étiage en période sèche (évalué à 500 litres/m²/an);
- l'atténuation des effets de crues par stockage d'eau lorsque la tourbière n'est pas encore saturée;
- le ralentissement des écoulements de surface par épanchement de la nappe d'eau.
|
Echanges d'eau: c en période de crue e en période d'étiage |
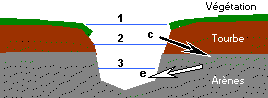 (d'après F. Gazelle) |
Niveaux du ruisseau: 1 en période de crue 2 habituel 3 en période d'étiage |
L'apport en eau de ces tourbières se faisant de façons diverses,(pluie, pluie du bassin versant ruisselant sur la sagne, eaux infiltrées, ruisseau), il est très important de considérer les tourbières à l'échelle de leur bassin versant !
|
Intérêts paléo-écologiques: la palynologie |
|
| Autres intérêts |
|
